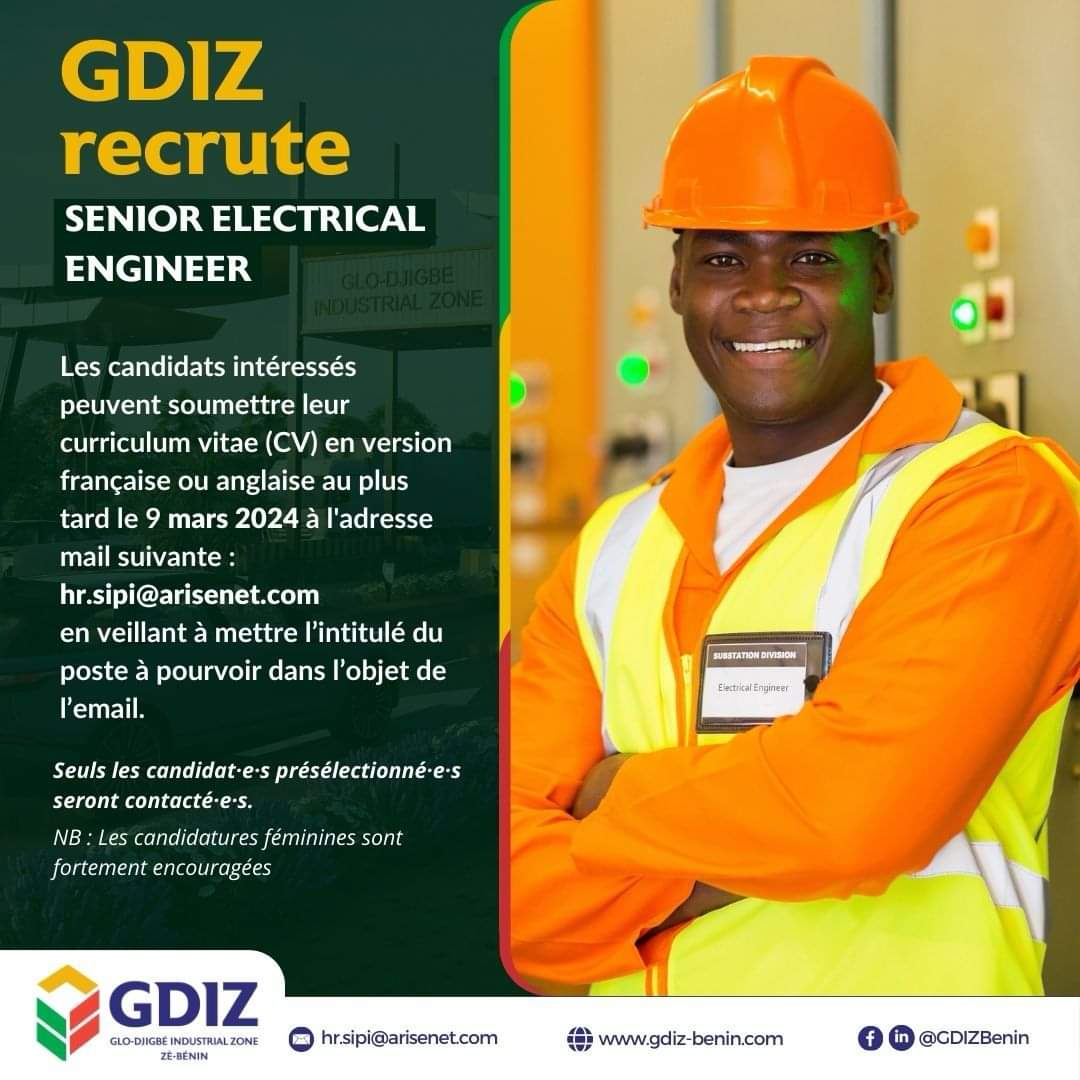À l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou, le 11 septembre 2025, les parties prenantes du projet SIMBLE ont présenté les acquis d’une initiative financée par l’Union européenne et coordonnée par l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, ouvrant la voie à la production locale d’intrants biomédicaux.
Le projet SIMBLE, lancé il y a quelques années, était perçu comme une initiative ambitieuse. Son objectif : tester la possibilité de produire localement, au Bénin, des intrants biomédicaux essentiels tels que les milieux de culture pour le diagnostic des infections sanguines. À l’heure où la dépendance des pays africains vis-à-vis de l’extérieur constitue un frein à l’efficacité des systèmes de santé, SIMBLE est venu apporter la preuve qu’une alternative crédible existe.
Dès l’ouverture des travaux, le professeur Dissou Affolabi, directeur général du Centre National Hospitalier et Universitaire de Pneumologie et de Phtisiologie (CNHU-PPC), a mis en avant la pertinence du projet. Selon lui, l’initiative a non seulement permis d’aborder la problématique de l’approvisionnement en intrants de santé, mais aussi de montrer que des solutions locales sont possibles si les compétences, les moyens et la volonté politique sont réunis. Il a salué l’engagement des partenaires techniques et financiers, tout en insistant sur la nécessité de consolider les acquis pour en faire un levier durable au service du système de santé.
L’ambassadrice de Belgique au Bénin, Mme Sandrine Platteau, a souligné la portée stratégique du partenariat entre l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers et les institutions béninoises. Pour elle, SIMBLE dépasse le cadre d’un simple projet technique. « C’est une vision commune d’un système de santé renforcé, d’institutions locales autonomisées et d’innovations durables », a-t-elle déclaré. Elle a rappelé que le programme a permis de former plus d’une centaine de professionnels de santé, de mettre en place des réseaux de laboratoires spécialisés dans la tuberculose et la résistance antimicrobienne, et de faciliter l’accès aux soins dans des zones jusque-là difficiles d’accès. L’ambassadrice a invité les parties prenantes à poursuivre dans cette dynamique, en investissant davantage dans l’excellence scientifique et dans l’esprit entrepreneurial local.
Au nom du ministère de la Santé, le professeur Francis Dossou, directeur général de la médecine hospitalière et des exploitations diagnostiques, a insisté sur la valeur démonstrative de SIMBLE. Selon lui, l’initiative montre qu’il est possible de réduire la vulnérabilité des pays africains aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. « Les résultats de ce projet appellent à investir dans des systèmes locaux, autonomes et résilients », a-t-il affirmé, ajoutant que l’expérience béninoise pourrait inspirer d’autres pays de la sous-région.
Au fil des échanges, les participants, venus de divers horizons, ont partagé leurs expériences et leurs perspectives. Les discussions ont mis en avant un constat unanime : la production locale d’intrants biomédicaux n’est plus une hypothèse théorique mais une réalité concrète. Elle constitue désormais une voie crédible pour garantir une sécurité sanitaire durable en Afrique subsaharienne. En filigrane, SIMBLE apparaît comme bien plus qu’un projet scientifique. Il illustre une nouvelle approche de la coopération internationale, fondée sur le renforcement des capacités locales plutôt que sur une dépendance prolongée vis-à-vis de l’extérieur. En produisant sur place des intrants de qualité répondant aux standards internationaux, le Bénin prouve qu’il est possible de concilier innovation, rigueur scientifique et adaptation aux réalités africaines. Cette réunion des parties prenantes a permis de dresser un bilan positif, tout en ouvrant des perspectives pour l’avenir. La question n’est plus de savoir si la production locale est possible, mais comment l’étendre, la pérenniser et l’intégrer dans les politiques nationales de santé. Le projet SIMBLE, en posant les bases d’une telle dynamique, a franchi une étape décisive. L’enjeu, désormais, est de transformer ce modèle pilote en un levier de souveraineté sanitaire pour l’Afrique, afin que les défis liés à l’approvisionnement en produits de santé ne soient plus un frein, mais une opportunité de développement scientifique et industriel.
Mechack AHOUANDJA