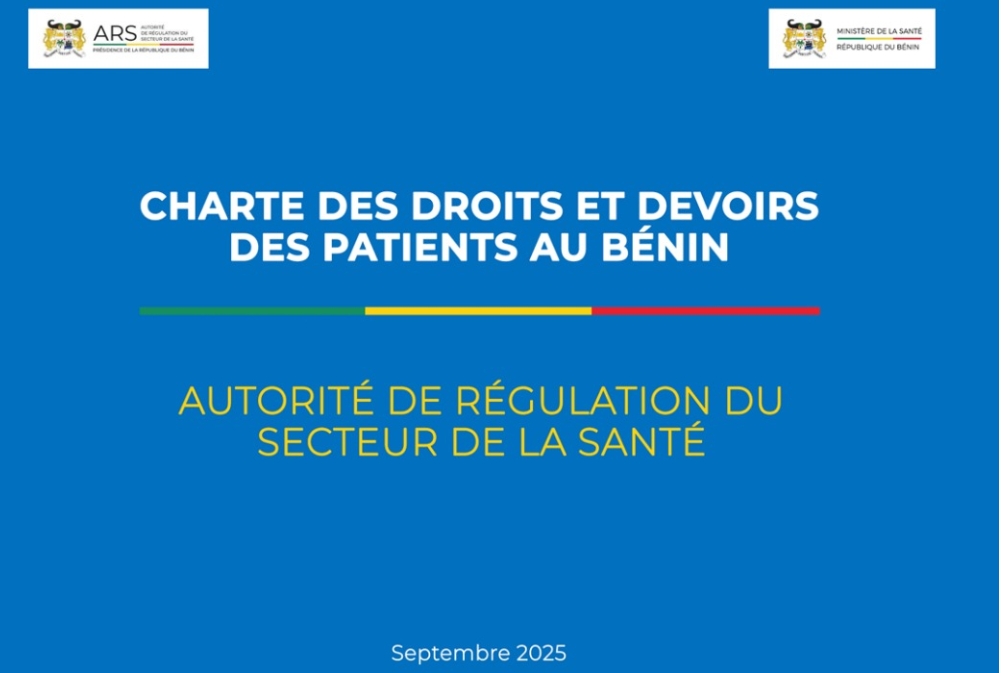L’ouverture du tout premier colloque international sur l’archéologie préventive et l’aménagement du territoire au Bénin a été faite, ce mercredi 15 octobre 2025 à l’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi, par le représentant du Recteur, le Dr Romain HOUNZANDJI, en présence du directeur de l’Institut National des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture (INMAAC), le Professeur Romuald TCHIBOZO. Pendant trois jours, universitaires, experts, décideurs publics et acteurs du BTP réfléchiront ensemble à une meilleure articulation entre développement des infrastructures et sauvegarde du patrimoine archéologique national.
L’objectif général de ce colloque est de renforcer la conscience collective sur l’importance de l’archéologie préventive dans la planification et la mise en œuvre des projets d’aménagement du territoire au Bénin. Il s’agit de proposer des mécanismes concrets permettant d’intégrer l’archéologie préventive dans l’étude d’impact environnemental, afin de préserver la mémoire historique du pays tout en favorisant un aménagement durable et harmonieux de l’espace.
Lors de la cérémonie d’ouverture, le Dr Romain HOUNZANDJI, représentant le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, a ouvert son intervention en présentant les excuses du Recteur, retenu par une séance avec les auditeurs de la Cour des Comptes. Il a ensuite salué et remercié l’équipe dirigeante de l’INMAAC, en particulier le Professeur Romuald TCHIBOZO, pour son engagement à organiser régulièrement des rencontres scientifiques. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les partenaires présents, tels que WAPCO, ainsi que les intervenants venus de Toulouse, pour leur contribution à un échange scientifique enrichissant.
Le Dr HOUNZANDJI a rappelé l’importance de l’Université dans la production et la diffusion du savoir et dans la stimulation de la recherche au Bénin. Il a souligné que ce colloque permet de réfléchir aux grands défis de la société, notamment la protection du patrimoine culturel face à l’urbanisation et aux projets d’aménagement. Selon lui, malgré les efforts et la volonté de l’État, une partie du patrimoine continue d’être détruite, ce qui rend la mise en place de l’archéologie préventive essentielle.
Lors de la même cérémonie, le Professeur Romuald TCHIBOZO a lancé un vibrant appel à la prise en compte systématique de l’archéologie préventive dans tous les projets d’aménagement. « Nous avons constaté qu’il existe très peu d’études d’impact archéologique au Bénin », a-t-il déploré, avant d’inviter les acteurs du BTP et les ministères sectoriels à collaborer avec les chercheurs pour « mieux comprendre les mécanismes existants et proposer des solutions adaptées ». Le Directeur de l’INMAAC a rappelé que l’un des objectifs majeurs de son institut est de former des professionnels de terrain, capables de conduire des études d’impact archéologique et de participer activement à la sauvegarde du patrimoine national. « Nous ne formons pas seulement des chercheurs, mais également des praticiens capables d’intervenir sur le terrain », a-t-il insisté.
Saluant la présence de ses partenaires de l’Université de Toulouse, il a qualifié cette coopération de « pierre angulaire du travail archéologique au Bénin », notamment à travers les fouilles conjointes et les échanges scientifiques. Il a enfin plaidé pour un aménagement du territoire qui prenne sérieusement en compte le patrimoine, rappelant que « la plupart de nos héritages archéologiques sont détruits chaque jour ».
Perspectives scientifiques et coopération internationale
Pendant trois jours, les participants passeront en revue les enjeux, les défis et les perspectives de l’archéologie préventive à travers une série d’activités scientifiques et culturelles. La première journée est consacrée aux conférences inaugurales et aux échanges thématiques autour des fondements juridiques et pratiques de l’archéologie préventive. Des communications de haut niveau aborderont notamment l’arsenal juridique béninois, l’expérience française en archéologie préventive, ainsi que des études de cas sur les découvertes archéologiques le long de la Route des Pêches ou encore les contraintes socio-culturelles de l’aménagement urbain à Abomey.
La deuxième journée sera marquée par deux grandes tables rondes. La première portera sur la législation et l’aménagement du territoire, en présence de représentants d’entreprises de BTP et de ministères sectoriels tels que les Travaux publics, le Cadre de vie et le Plan. La seconde table ronde s’intéressera aux expériences des entreprises d’aménagement du territoire en rapport avec l’archéologie préventive et la protection du patrimoine culturel, avec la participation d’acteurs comme Porteo BTP, WAPCO, ADEOTI, SATOM-SOGEA et ONIP.
Enfin, la journée du vendredi 17 octobre clôturera les travaux sur une note à la fois scientifique et culturelle, avec une sortie touristique sur la Route des Pêches, symbole vivant du dialogue entre patrimoine, histoire et développement.
Soutien des experts
L’expert toulousain Gabriel MUNTEANU, impliqué dans une opération de fouilles archéologiques liées à l’exploitation de minerais de fer dans la région d’Aplahoué, a salué l’initiative de l’INMAAC. « Le Bénin a un énorme patrimoine qui doit être conservé et mis en valeur. Ce type d’événement est essentiel pour que cela se mette en place », a-t-il souligné. Il a insisté sur l’importance de créer des mécanismes concrets permettant de protéger le patrimoine tout en favorisant le développement économique et industriel du pays.
De son côté, Sabi Sika GUERA, géologue à l’Office béninois de la recherche géologique et minière (OBRGM), a mis en lumière les enjeux locaux. Commentant la projection d’un film illustrant l’état de délabrement du palais du roi Glèlè, il a attiré l’attention sur une carrière de latérite ouverte par une mairie, dont l’exploitation aurait provoqué l’effondrement d’une partie de la clôture du site. Selon lui, cette situation illustre la nécessité d’une meilleure coordination entre les acteurs des mines et ceux du patrimoine afin de concilier développement et préservation culturelle.
Ozias Satingo